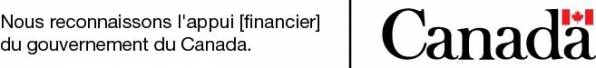Attrapez un livre. Disséquez-le méticuleusement.
Vous constaterez qu’il ne recèle pas d’épididyme. Comment alors expliquer qu’il soit masculin ?
Prenez une livre. Examinez-là sous toutes ses coutures. Vous voyez bien qu’elle ne possède pas de glandes de Bartholin. Pourquoi donc est-elle féminine ?
Peut-être que les attributs humains permettant de différencier les genres ne s’appliquent pas aux objets. Poursuivons l’expérience pour en avoir le cœur propre. Le sexe a un grand objectif : la reproduction. Accouplons donc un livre et une livre. Il faut se rendre à l’évidence sans y aller par quatre chemins : aucune progéniture ne naîtra jamais de cette union.
Force est d’avouer que le genre attribué aux choses n’a aucun rapport avec leur être. Mais d’où vient donc le sexe des objets ?
Cette question me turlupine depuis un bout. Le genre a un impact majeur sur la langue. Il en complique l’apprentissage et la maîtrise. Il exige d’apprendre par cœur ce qui est féminin ou masculin. Ça en fait beaucoup à mémoriser. Viennent ensuite les accords de tout acabit à effectuer dans les multiples règles de l’art.
Puisque la langue incarne notre pensée, ses caractéristiques traduisent et modèlent notre perception du monde. Le genre me préoccupe car il porte assurément des dimensions sexistes. Par exemple, dès la plus tendre enfance on nous apprend que le masculin l’emporte sur le féminin. Il suffit d’un homme parmi 1000 femmes pour que celles-ci soient supprimées du discours.
Un avion, une voiture, un autobus, une fourchette, un four, quand on observe le sexe des choses, on ne discerne aucun lien. On pourrait croire qu’il est attribué par le plus pur des hasards. Peut-être pas.
En effectuant des recherches sur le sujet, je suis tombé sur un article très intéressant de Patrizia Violi, assistante en sémiotique à l’Institut de la Communication de l’Université de Bologne en Italie. Dans «Les origines du genre grammatical» disponible sur le site internet persee.fr, Mme Violi postule que «la langue n’est pas neutre. Son organisation influence le système symbolique et cognitifs des sujets parlants, puisque les genres tendent à être vécus comme des catégories naturelles auxquelles ramener les expériences de la réalité».
Violi relève que pour les linguistes, le genre est «arbitraire», «illogique» et «immotivé». Pas tant, illustre-t-elle en retournant à des oppositions de base de l’expérience humaine : le jour et la nuit, le soleil et la lune, la vie et la mort, la lumière et l’obscurité.
Ces éléments, souligne-t-elle, sont «investis d’un symbolisme sexuel». Comment ça se traduit dans le genre ? Ça dépend et ça peut changer. Violi donne l’exemple de la lune et du soleil qui étaient vraisemblablement des mots masculin et féminin dans l’indo-européen primitif. Soit le contraire d’aujourd’hui en français.
Selon les recherches de l’auteure, le genre du soleil et de la lune se serait inversé avec «l’évolution de la société dans le sens patriarcal». Le soleil serait devenu le symbole de la virilité et la lune de la féminité. «Cette symbolisation serait ensuite passée dans la mythologie grecque et latine, où Phébus-Apollon, conducteur du char solaire, s’oppose à Diane-Artémis, symbolisée par la faux lunaire», indique Violi.
Sur cette matière à réflexion, je sous souhaite bonne après-midi ou bon après-midi. C’est au choix du chef, après-midi est hermaphrodite.
Le mot peut être à la fois masculin et féminin. «L’usage est flottant et les deux genres sont acceptés», selon l‘Office québécois de la langue française. Alors vive l’usage flottant !