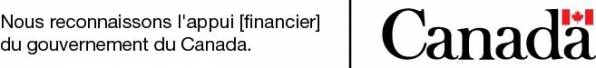Les réserves en eaux souterraines inquiètent, notamment à Mercier. La nappe phréatique se fragilise en raison des changements climatiques et des pratiques agricoles, note la mairesse de Mercier Lise Michaud. Les besoins en eau de la part des municipalités, industries et agriculteurs sont à la hausse, dit Québec.
Le portrait géographique de Mercier se veut majoritairement agricole. Les productions maraîchères et de grandes cultures occupent 90 % du territoire.
Les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents depuis les dernières années. Durant ces moments précis, les agriculteurs irriguent leurs terres à partir de l’eau puisée en profondeur, explique Mme Michaud. «Je les comprends. Ils veulent maximiser leur productivité», reconnaît-elle. À l’inverse, les agriculteurs drainent leurs terres à la suite de fortes pluies. «Elle [la pluie] n’a pas la possibilité de se rendre à la nappe d’eau souterraine», poursuit-elle. Le bas niveau de la nappe phréatique touche les propriétaires en zone agricole. «Les puits artésiens des résidences s’assèchent», mentionne la mairesse.
Après les canicules, la pluie… lorsqu’elle tombe, elle prend la forme d’ondées et demeure dans les réseaux de surface. Elle contribue à l’érosion des berges et provoque des inondations, souligne Lise Michaud.
Toute la Montérégie
Le niveau de la nappe phréatique baisse. Cela impacte toute la Montérégie, confie la mairesse. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) est concerné, lance-t-elle.
La mairesse a multiplié ses représentations auprès de Québec au cours de la dernière année. Elle interpelle le MELCCFP. Son souhait : l’amener à réglementer et «poser des gestes concrets».
Besoins en eau des secteurs municipal, industriel et agricole
Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs observe une augmentation des besoins en eau en Montérégie. Ces besoins proviennent des agriculteurs, mais aussi des municipalités et industries. Leur consommation exerce «une pression sur les ressources dans un contexte de disponibilité en eau plus limitée par endroits». Une baisse du niveau de la nappe phréatique conduit à «des conflits entre les usages, créant notamment des problèmes d’approvisionnement en eau résidentielle», dit la relationniste de presse au ministère Josée Guimond.
Le professeur-chercheur en physique du sol à l’Université Laval à Québec Jean Caron abonde dans le même sens. La hausse du niveau de la nappe phréatique demande un effort collectif, incluant les municipalités. L’urbanisation, telle qu’on la connaît avec les espaces asphaltés et bétonnés, nuit au processus. «De plus en plus, les villes aménagent des zones de captation pour recharger les nappes, forcent les citoyens à avoir des puits secs pour éviter que l’eau de pluie s’en aille dans les égouts de surface et retourne éventuellement à la rivière Châteauguay puis au fleuve», souligne M. Caron.
La quantité d’eau au Québec ne constitue pas un problème généralisé, mentionne le MELCCFP dans le Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, publié en juin. Il fait état plutôt de problèmes d’approvisionnement irréguliers. «Le rapport précise que cela se produit surtout lors d’étés secs et dans les régions qui connaissent une croissance démographique et qui sont en développement dans le sud du Québec. Avec les changements climatiques, les périodes de faible disponibilité de l’eau augmenteront en fréquence et en sévérité dans le Québec méridional», affirme Mme Guimond.
Québec intervient en matière de sécurité des approvisionnements en eau potable dans les régions où il note une pression sur les ressources. Comment? Par une diminution des prélèvements d’eau lorsqu’elle est moins disponible. «Cette approche sera testée pour les eaux de surface dans le cadre d’un projet pilote. L’approche pourrait éventuellement s’étendre aux eaux souterraines», précise Mme Guimond. Le MELCCFP a injecté plus de 60 M$ en programmes d’aide financière dans le milieu municipal.